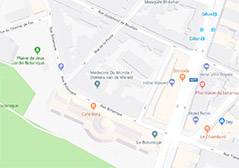Elle s'appelle Annie et dirige Afia Mama, une association féministe en République démocratique du Congo. Aux côtés de militants comme le prix Nobel de la paix Dr. Denis Mukwege, elle lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre.
Je m’appelle Annie Tenga Modi.
Je suis mère d’une fille de 18 ans que j’ai eu adolescente. J’ai 37 ans. Et depuis 13 ans, suis orpheline.
Je dirige une organisation appelée Afia Mama. Je suis directrice exécutive et cofondatrice. Je suis une activiste féministe pour le droit de la femme en général et aussi les jeunes, la question de leur leadership et de leur participation me passionne.
J’habite Kinshasa depuis 4 ans. Je reviens d’Afrique du Sud où j’étais réfugiée pendant plus de 10 ans.
Toute petite, j’étais la princesse de mon père qui, lui, faisait de la politique pendant la deuxième république du Zaïre, en son temps. Il est décédé alors que j’avais à peine 13 ans. C’était un an avant le génocide et deux avant la première guerre dite de « la libération ».
Orpheline, j’ai été déplacée pour aller vivre à l’Est de la RDC. Dans la ville de Goma, très connue pour le nombre de guerres qu’elle a connues. Mais aussi pour les violences sexuelles et basées sur le genre dont les femmes et les filles ont été victimes pendant des années.
J’ai vécu à Goma en tant qu’adolescente, rejetée par ma communauté à cause de mon apparence physique qui faisait de moi quelqu’un d’une ethnie à laquelle je n’appartenais pourtant pas.
À 17 ans, pendant la guerre, je suis devenue mère.
J’ai eu ma fille à Goma, pendant la guerre. Arrivées à Kinshasa, le rejet continue. Au niveau psychologique pour une adolescente c’est beaucoup de pressions. C’est beaucoup de souffrances. En même temps on doit être mère pour sa fille alors qu’on est soi-même encore un enfant.
Je reprends mes études à Kinshasa pratiquement 4 ans après pour avoir mon BAC. Mais même à Kinshasa mon apparence ne me permet pas de vivre librement. Mon oncle a décidé de m’envoyer en Afrique du Sud où j’ai vécu pendant plus de 10 ans en tant que réfugiée.
Ça a été très dur. C’est pendant ce moment de vie de réfugiée que j’ai fait le vœu de devenir la Voix des sans Voix.
J’ai commencé mon activisme dans les centres d’accueil des réfugiés où je partais plaider pour les femmes et les filles réfugiées qui n’avaient pas accès aux services minimums pourtant disponibles et gratuits, parce qu’elles n’avaient pas l’argent pour corrompre parfois, elles ne pouvaient pas parler la langue, elles n’avaient pas la force pour se bousculer à la porte pour accéder.
Petit à petit on s’est rendu compte que les femmes de mon pays d’origine avaient plus besoin de moi, surtout lorsqu’on a appelé mon pays « la capitale du viol ». Parce qu’on y utilisait la violence sexuelle comme une arme de guerre. C’est à ce moment que j’ai été très tentée de revenir et contribuer, porter la voix de celles qui sont restées, de celles qui ont continué à vivre la violence, la souffrance que je connais personnellement et dont j’ai eu la chance de sortir.
Je me suis décidée, encore une fois, de revenir, de voir comment je pouvais contribuer, à amplifier, faire entendre la voix de cette femme, mais aussi l’aider dans l’amélioration de son statut, de son bien-être, dans son autonomisation économique, dans son développement personnel, et dans sa participation à la gestion du pays qui est le nôtre : la RDC.
Les guerres en RDC, mais surtout à l’Est de la République démocratique du Congo, ne sont pas seulement politiques, c’est aussi une guerre pour l’accès à la terre pour les uns, et pour maintenir le contrôle sur cette terre, pour les autres. Dans cette multitude de relations de pouvoirs et de forces, on s’est rendu compte que dans la culture africaine en général mais congolaise de cette partie en particulier, la femme était un trésor. La femme représentait un peu la fierté de l’homme qui la possède. Donc, une façon d’humilier son ennemi et de l’anéantir pour prendre le contrôle sur son espace a été identifié, c’était de toucher le point le plus sensible qui est de prendre les femmes, les filles, les violer systématiquement devant ces hommes. Et après on a transformé les enfants qui vivaient ça, en machine de guerre, des machines à tuer.
Ça se fait de manière systématique, j’ai commencé à le dire, comme les autres, nous n’allons pas arrêter jusqu’à ce qu’un jour le monde reconnaisse que ça a été un génocide. Utiliser de cette manière-là la violence pour montrer sa victoire sur les camps adverses.
On a le Dr Mukwege, le Prix Nobel qu’il a reçu, pour nous c’est une reconnaissance que cette souffrance a bel et bien existé, et qu’une personne qui a contribué à alléger la souffrance des femmes pouvait être reconnue et ça, ça nous a soulagés alors ce sera reconnu que c’est un génocide, c’est pour cela la RDC a été appelée la capitale du viol.
Une femme qui est violée comme ça, elle est morte. Elle ne vit plus. Après avoir subi un tel acte, on ne vit plus. On respire, on survit. Souvent c’est pour les autres. Pas pour soi-même. Si on a eu des enfants, si on a une famille, c’est pour ces gens-là qu’on continue à respirer.
Nous vivons dans un système patriarcal, où il y a beaucoup de « valeurs », que je mets entre guillemets, qui définissent ce que doit être la femme. Comment elle doit se comporter, ce qu’elle doit faire et la faute d’avoir été violée est mise toute entière sur la femme pourtant victime de cette situation. Ce qui permet aux femmes de développer la résilience, c’est souvent la solidarité entre celles qui ont expérimenté le même type de violences, ou même des types différents de violences. Ce partage d’expériences ou de douleurs. Après, il y des zones où il y a eu beaucoup d’actions humanitaires, beaucoup de sensibilisation et ça aide.
La santé sexuelle et reproductive de la femme après ces expériences reste un problème. On n’a pas beaucoup d’hôpitaux avec des dispositions pour prendre en charge les cas de fistules, par exemple. Le manque d’informations, l’analphabétisme qui est très élevé, créent aussi une barrière. Beaucoup d’éléments produits sont en français pas en langue vernaculaire ce qui fait que même lorsque c’est disponible, ça n’est pas dans la langue que la majorité des femmes utilisent, elles ne peuvent pas consommer ces informations donc ça ne les aide pas beaucoup.
Notre travail d’activistes des droits de la femme en tant que congolaises, consiste premièrement à faire entendre et à faire participer la femme.
Nous sommes dans un pays où le cadre légal nous protège beaucoup. Ça je dois le reconnaître. On a beaucoup de droits sur le papier. Mais son application pose problème. À chaque fois qu’on discute de nos droits, la femme est toujours minoritaire, on n’a jamais eu plus de 15 % de femmes au Parlement. Ça veut dire que c’est majoritairement les hommes qui ont décidé de la limite de la parcelle de droits qui devaient nous revenir.
Deuxièmement, que ce soit dans le système judiciaire, il n’y a pas beaucoup de femmes donc l’application de ces lois reste un problème. Nous nous sommes donné la mission pendant que sur le terrain, nous sensibilisons, nous facilitons l’accès à l’information, parce que ne peut revendiquer ses droits que celui qui a la connaissance.
Plus nous aurons de personnes sensibilisées dans les positions décisionnelles, plus on peut espérer avoir un changement de mentalité progressif. On a parlé de la stigmatisation, de la discrimination, tout cela est dû à la mentalité, le mindset qu’ont les gens. Les gens sont restés figés sur ce qu’on dit à l’église et sur ce que les coutumes disent.
Mais même lorsque nous avons tous vécu la guerre, même lorsque nous avons tous vu cette femme violée devant toute la famille, on pense quand même que c’est sa faute.
s' Inscrire à la newsletter
Contactez-nous
Médecins du Monde
Faites un don : BE26 0000 0000 2929
Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 225 43 00
info@medecinsdumonde.be
TVA: BE 0460.162.753